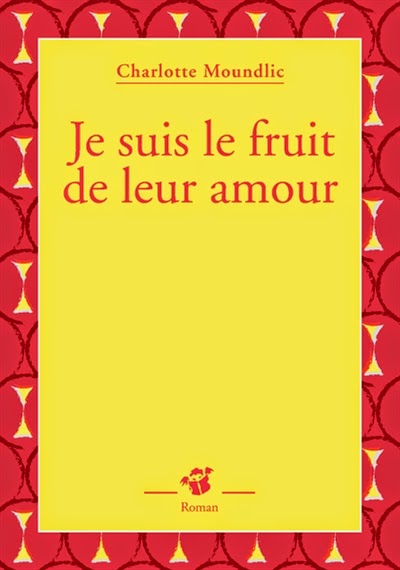Quand Jean, alias John B. Root, célèbre réalisateur de films pour adultes, propose a son ami Olivier Milhaud d’interpréter le rôle d’un policier dans sa nouvelle production, ce dernier se montre d’abord hésitant. Bien sûr, il ne jouera que des scènes de comédie, mais quand même ! Après avoir obtenu le feu vert de sa compagne et de son éditeur, il finit par accepter et se retrouve immergé dans un univers dont il ne connait pas les codes.
Mettons tout de suite les choses au point, il n’y a aucune image à caractère sexuel dans cet album. Quel intérêt de le lire alors ? me direz-vous, bande de coquins ! Et bien en ce qui me concerne et comme toujours, une curiosité intellectuelle sans limite qui me pousse à explorer des domaines auxquels je ne connais strictement rien. Ben oui, le porno et moi ça fait deux (j’en vois déjà qui rigolent au fond). Mon gros problème avec ce genre de film, c’est que les (très) rares fois où j’ai essayé d’en visionner, je n’ai jamais vu la fin. Bizarrement, je m’endors toujours à un moment donné et je ne m’explique pas ce coté soporifique (ok, j’ai conscience que l’excuse du sommeil pour justifier le fait de ne jamais aller au bout d’un porno ne va pas convaincre grand monde mais je tente quand même le coup…). Tout ça pour vous dire que je me suis plongé dans cet ouvrage avec un regard de sociologue, loin de tout voyeurisme, cela va de soi (et je vois toujours les mêmes qui rigolent au fond).
Les coulisses d’un film X (du moins celui-là) n’ont pas le coté glauque auquel je m’attendais. Déjà, le lieu du tournage (une villa dans le sud de la France avec piscine) est loin du hangar désaffecté et crado que l’on voit parfois (enfin je suppose, vu mon peu d’expérience en la matière). Ensuite il y a beaucoup de décontraction, on a l’impression d’être dans une colo (une colo certes un peu spéciale), même si au moment des prises de vue, le professionnalisme reprend le dessus et rien n’est laissé au hasard.

Plutôt timide et introverti, Olivier Milhaud se montre discret. Il découvre la concurrence énorme entre les filles qui engendre jalousies et vacheries, le pétage de plomb de certains acteurs se comportant parfois comme de vrais branleurs (oui, je sais, elle était facile mais j’aime céder à la facilité) et les questionnements existentiels d’un réalisateur qui a perdu la foi depuis l’arrivée des sites porno gratuits. Il se rend aussi compte que les discussions au petit déj peuvent mettre mal à l’aise. Exemples : «
Jean, ça t’embête si pour la scène je mets pas le collier. Je vais sucer, sinon c’est chiant avec. » / «
Bon, là ça va, je peux boire un café, j’ai pas de sodo, parce que sinon… » / «
Je commence à me faire vieux, j’ai du bide, ça le fait pas. Et j’en ai marre de me raser les couilles. » Forcément, on ne parle pas de la météo.
L’album est vraiment agréable, drôle et léger, mais honnêtement, la vision du milieu présentée ici me paraît un peu idyllique. Sans doute parce que John B. Root est un réalisateur respectueux et à l’écoute, ce qui est loin d’être le cas de ses confrères, comme le précise une actrice :
« Les filles qui commencent le métier avec lui pensent que c’est partout pareil. Elles se disent que c’est pas du tout sordide et enchaînent avec un tournage à Budapest. Et là… c’est l’abattage ». N’empêche, il ne m’aurait pas déplu d’être à la place d’Olivier Milhaud pour me faire ma propre idée. Par pure curiosité intellectuelle, évidemment…
Explicite : Carnet de tournage d’Olivier Milhaud et Clément C. Fabre. Delcourt, 2015.
124 pages. 16,95 euros.