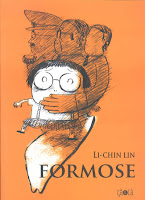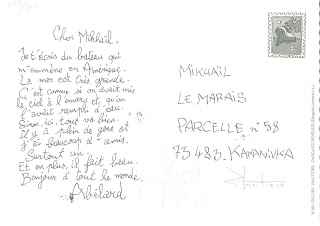|
| Brubaker et Phillips © Delcourt 2007 |
« Le truc à savoir, c’est que la plupart des plans, même les bons, sont des châteaux de cartes. Le moindre détail qui foire, et tout se casse la gueule. » Léo savait qu’il n’aurait pas dû dire oui. Des flics véreux qui réunissent une équipe pour faire main basse sur cinq millions en diamants, c’était trop gros. Il a d’abord refusé, mais Greta est entrée en scène. Pour ses beaux yeux, il a fini par accepter. Il faut dire aussi que Léo n’est pas un débutant. Dans le milieu, il est réputé pour mettre au point les plans les plus minutieux. Avec lui, rien n’est laissé au hasard, tout est calculé au millimètre. Et s’il ne s’est jamais fait poisser, c’est pour une autre raison. Léo est un froussard. Au moindre signe de pépin, il décroche ventre à terre et tant pis pour les petits copains. Pas reluisant comme attitude, mais la survie est à ce prix. Seulement, cette fois-ci, les choses vont prendre une tournure différente. Il le savait pourtant, il ne faut jamais faire confiance à un flic ripoux…
Le rouge crépusculaire de la couverture annonce la couleur. Criminal est un polar sans concession. Un « héros » en perdition, des méchants vraiment méchants, une femme qui vient brouiller les cartes, beaucoup de violence et une fin tragique… tous les ingrédients sont réunis pour concocter un petit noir bien serré. Le scénariste Ed Brubaker donne dans l’efficacité. Il tisse sa toile avec une précision diabolique alternant temps forts et moments calmes tout en insérant ici et là quelques flash back bienvenus. Il plonge dans les bas fonds et met en scène des protagonistes au sens moral plus que douteux. Les attitudes et les dialogues sonnent juste, sans chichi ni fioriture. Du travail ciselé.
Niveau dessin, Sean Phillips s’applique pour rester dans le ton avec un encrage épais, un gros travail sur les ombres et un découpage au cordeau qui rend la tension parfaitement palpable. La violence est omniprésente mais elle n’est jamais surjouée, la mise en scène des différentes fusillades restant au final assez sobre.
En matière de polar, Criminal est devenue une référence. Avec mon chouchou Scalped, c’est sans doute la série noire actuelle la mieux troussée. Avis aux amateurs du genre qui ne connaitraient pas ce petit bijou : vous pouvez foncer les yeux fermés.