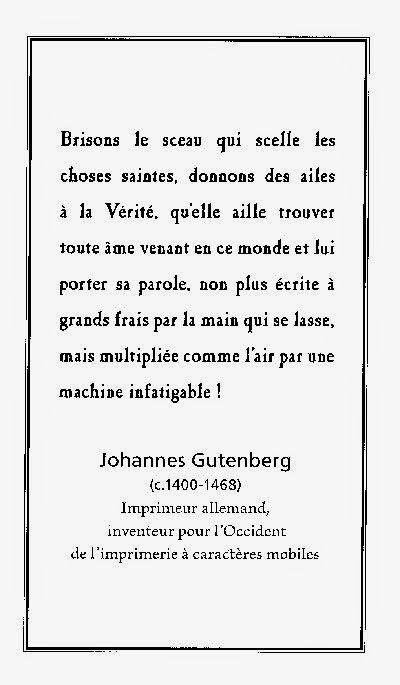Des soldats. Américains. En Irak. Celui-là rentre chez lui après avoir passé son temps, là-bas, à abattre des chiens qui se nourrissaient de cadavres. A la maison il retrouve sa femme et son labrador, couché au pied du canapé. Celui-là vient de délivrer des policiers irakiens torturés dans la cave d’une maison tenue par des insurgés. Celui-là a du mal à se remettre de la mort d’un gamin de 14 ans, tué sous ses yeux par son collègue. Lui, il était affecté aux « affaires mortuaires », chargé de récupérer et transporter les corps de combattants, qu’ils soient américains ou irakiens. Cet autre, civil, rêvait de remettre en service une station de traitement de l’eau pour venir en aide à la population. Eux, ils débriefent à la cantine après avoir envoyé leur premier obus sur des cibles humaines. Combien en ont-ils eu en tout ? Combien ça fait de morts par membre de la section ? Et puis il y a cet aumônier recueillant des confessions difficiles à entendre, cet étudiant revenu du front, pointé du doigt par une camarade musulmane sur les bancs de la fac ou encore ce pauvre gars, défiguré par une mine, qui raconte son histoire dans un bistrot de New-York...
Attention, grosse claque ! Douze nouvelles que j’ai dévorées en à peine deux jours. On comprend à la lecture pourquoi ce recueil d’un débutant totalement inconnu s’est vu octroyer le National Book Award, l’un des plus prestigieux prix littéraires de la planète.
Phil Klay, vétéran du corps des marines ayant servi en Irak entre 2007 et 2008, a l’intelligence de ne pas sombrer dans les clichés, de ne pas jouer au « pro » ou au « anti » guerre. Son angle d’attaque est beaucoup plus fin : de l’artilleur à l’aumônier, du civil engagé par l’armée à l’administratif n’ayant jamais vu une zone de combat, il multiplie les points de vue et alimente la réflexion. Avec un réalisme sidérant, il décrit la vie d’une compagnie au jour le jour, il dit la peur du soldat sur le terrain, la haine absolue et aveugle de l’ennemi, les traumatismes physiques et psychologiques, l’impossible retour à une vie normale à la fin d’une mission, mais aussi l’incompréhension des proches, la quête de sens face à l’absurdité de certaines situations, les nombreux suicides, le regard, parfois difficile à supporter, de ceux qui vous jugent sans avoir la moindre idée de ce que vous avez vécu.
Aucun pathos, aucun jugement, pas d’envolée lyrique, le ton est sec comme un coup de trique, empreint d’une lucidité qui fait froid dans le dos. Plus proche, dans l’esprit, de «
Yellow Birds » que de «
Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn », deux autres textes abordant le conflit irakien, ce recueil marque la fracassante entrée en littérature d’un jeune trentenaire incroyablement talentueux.
Fin de mission de Phil Klay. Gallmeister, 2015.
310 pages. 23,80 euros.
Extraits :
«
J’avais pensé qu’il y aurait au moins une certaine noblesse dans la guerre. Je sais qu’elle existe. On raconte tant d’histoires, il faut bien que certaines d’entre elles soient vraies. Mais je vois surtout des hommes ordinaires, essayant de faire le bien, abattus par l’horreur, par leur incapacité à apaiser leur propre rage, par les airs virils qu’ils affectent et leur prétendue dureté, leur désir d’être plus implacables et par conséquent plus cruels que la situation dans laquelle ils se trouvent. »
«
Qu’est-ce qu’on fait ? […] Nous, on vient ici, on leur dit, On va vous apporter l’électricité. Si vous travaillez avec nous. On vous garantira la sécurité. Si vous travaillez avec nous. Mais attention, votre meilleur ami sera votre pire ennemi. Si vous nous faites chier, vous vivrez dans la merde. Et ils nous répondent, OK, on vivra dans la merde. Alors qu’ils aillent se faire foutre. »
«
Tout le monde présumait que mon âme était profondément marquée par ma rencontre avec le Réel : le monde-tel-qu’il-est, dur, sans fard, violent, loin de la bulle protectrice de l’Amérique et du monde universitaire, un séjour au Cœur des Ténèbres qui, s’il ne vous détruit pas, vous rend plus triste et plus sage. C’est des conneries, bien sûr. »