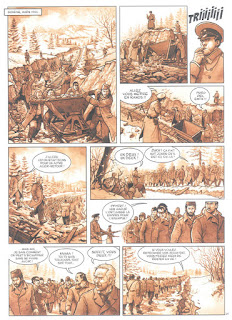Février 1939, dans une ville de Bohème. Les nazis enlèvent
des enfants tziganes pour mener des expériences abjectes au nom de la pureté
raciale. Leurs parents partent à leur recherche, accompagnés d’un
« gadjo » prénommé Josef, mais ils sont rapidement arrêtées par la
police et déportés au camp de travail de Lety puis à Auschwitz. Placés dans une
section baptisée Zigeunerlager (camp tzigane aussi appelé « camp de
famille » puisque les déportés peuvent y rester avec les leurs) ils vivent
dans des conditions difficiles, notamment à cause des ravages provoqués par le
typhus. Le 22 mars 1943 a lieu le premier gazage de tsiganes et dans la nuit du
1er août 1944, Himmler expédie dans les chambres à gaz les
survivants du « camp de famille ».
Un album très documenté qui revient avec une grande rigueur
historique sur le génocide tsigane, une tragédie qui, rappelons-le, n’a été
reconnue par le parlement européen que le 3 février 2011. Un pan méconnu de
l’holocauste où l’on découvre les terribles motivations du Reich : pour le
docteur Ritter, chef de L’institut de recherche pour l’hygiène raciale et la
biologie de la population, les tsiganes représentent un danger de
dégénérescence pour les allemands. Il préconise donc dans un premier temps le
rassemblement de cette communauté dans des camps de travail forcé et la
stérilisation massive. Son but est d’éviter tout métissage et, à terme
« d’éliminer ces êtres indignes de la société. »
Michaël Le Gali a aussi souhaité mettre en valeur les
traditions propres au peuple rom, leur vocabulaire, leurs croyances, leur façon
de rendre la justice, leur passion pour la musique et la difficulté pour eux,
nomades dans l’âme, de se voir à ce point priver de liberté de mouvement dans
les camps. Liant la petite et la grande histoire, il insère dans son récit une
part non négligeable de fiction, notamment à travers le personnage de Josef, le
gadjo témoin et narrateur de ce voyage au bout de l’horreur. C’est sans doute
dans cette part de fiction que réside les quelques faiblesses de l’album. La
voix de Josef est souvent trop « neutre », comme détachée des
événements qu’elle relate, d’une froideur presque clinique. Il manque ce petit
supplément d’émotion qui aurait donné à l’ensemble davantage d’ampleur.
Au niveau graphique, le dessin
réaliste et le choix des tons sépia donnent une patine particulière
parfaitement adaptée au propos.
Un album instructif abordant un
sujet trop méconnu, qui sonne comme un hommage des plus sincères au peuple
tsigane et à la tragédie qui l’a frappé. Il est juste regrettable qu’il soit
plus didactique que poignant.
Batchalo de Le Galli et Bétend. Delcourt, 2012. 80 pages. 14 euros.