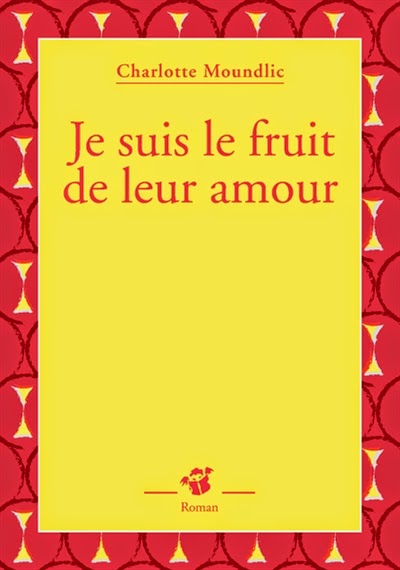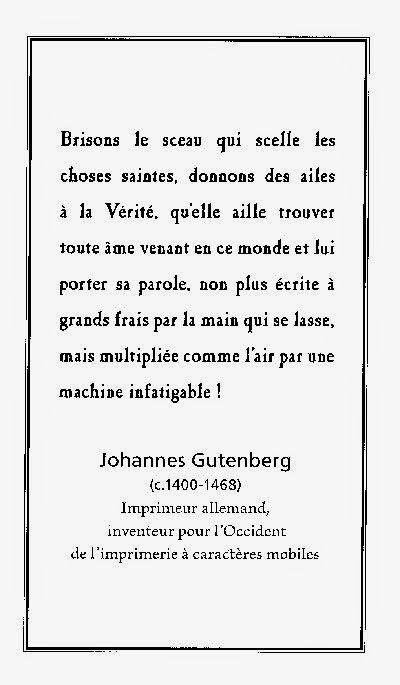J'ai toujours aimé les troquets. Mon grand-père m'y emmenait le samedi et le dimanche matin. C'était le début des années 80, j'avais 5-6 ans et j'étais la mascotte du « Paris-Calais ». J'y croisais des travailleurs évacuant la fatigue de la semaine et des retraités qui venaient y boire leur pension. J'y ai appris toutes les subtilités du Tiercé, j'ai enrichi mon vocabulaire avec les expressions les plus outrancières que l'on puisse imaginer, j'ai découvert la belote et le 421. J'avais droit à un Vittel menthe et je voyais défiler les ballons de rouge. La cigarette avait encore sa place au bar et en salle, la fumée était partout, les cendriers puaient le tabac froid. J'ai grandi dans ce troquet, entre le flipper et le babyfoot. Lycéen, j'y ai fréquenté un temps le génial Christophe, serveur poète et alcoolique qui m'a fait découvrir Breton. Avec lui, j'ai commis quelques excès mémorables et construit une réputation qui me poursuit encore parfois aujourd'hui. Objecteur de conscience, j'y prenais mon café chaque matin à 7 heures avec les ouvriers du petit jour aux yeux gonflés par le manque de sommeil et au corps meurtri par la journée de la veille. Et puis surtout, j'y ai rencontré celle qui allait devenir ma femme et la mère de mes filles. Aujourd'hui, le « Paris-Calais » existe toujours. Il a été rénové et aseptisé. On n'y fume plus, les banquettes en similicuir sont confortables et les tables ne sont plus nettoyées avec un torchon dégueulasse sorti d'une eau de vaisselle aussi trouble que celle des chiottes. La fin d'un monde.
Tout ça pour vous dire que je ne pouvais pas passer à coté de « ces contes de bistrot » signés d'un cinéaste américain débarqué à Paris à l'été 1960 sans un sou en poche et sans connaître un mot de français. Après une rencontre avec Choron, Cavanna et la clique d'Hara-Kiri, Van Peebles collabore à la revue en signant «
La chronique du gars qui sait de quoi il parle » et en prépubliant en grande partie «
Le chinois du XIVe ». Apprenant la langue de Molière dans la rue et les cafés, l'américain écrit comme on parle dans les arrondissements les plus populaires de la capitale. Il n'écrit pas dans sa langue natale mais parvient à trouver un ton très oral, aussi fluide que savoureux.
Le recueil, illustré par Topor, repose sur un principe simple et déjà-vu : dans un café du XIVe, alors que le quartier est plongé dans la pénombre par une coupure de courant, les clients se regroupent autour d'une lampe à pétrole et d'une bouteille de vin. Du patron à la bonne, du vieillard au clochard, chacun va y aller de son histoire. Des histoires drôles, tristes, crues ou cruelles. Pas des racontars de poivrots, plutôt des fragments de vie, des destins improbables brisés par la guerre ou la pauvreté. Chacun s’exprime à sa façon mais tous ont en commun une humanité débordante.
Ces histoires ont beau avoir plus de cinquante ans, elles me parlent. Et j’aurais adoré être autour de la table pour les partager, un verre à la main.
Le chinois du XIVe de Melvin Van Peebles. Wombat, 2015 (1ère édition en 1966).
155 pages. 17 euros.