Du 19 juin 1842 au 15 octobre 1843. Seize mois pendant lesquels la France a vécu au rythme des
Mystère de Paris. Le roman d’Eugène Sue est proposé chaque jour en feuilleton dans Le Journal des débats et chaque jour une foule se précipite pour découvrir la suite des aventures de Rodolphe, de Fleur de Marie, du Chourineur, du Maître d’école, de La Chouette et de tant d’autres. Les hommes politiques se passionnent pour l’intrigue, les critiques se déchirent sur la qualité « littéraire » du texte, les écrivains admirent ou jalousent le succès de leur confrère (Balzac le premier). On voit des portiers faire la lecture aux illettrés, on dit que des malades ont attendu la fin de la publication pour mourir. Les gravures reprenant des scènes clés du récit pullulent chez les libraires, on créé des statuettes des personnages, on baptise de leur nom des fleurs du jardin des plantes, on invente des jeux de l’oie, on écrit des chansons, on imagine des danses…
Les mystères de Paris deviennent un phénomène de société et Eugène Sue une star immense, sans aucun doute la plus grande vedette de son époque.
La recette de l’écrivain est simple : des personnages aux caractères marqués et caricaturaux (les bons d’un côté, les mauvais de l’autre), des figures fortes, monstrueuses ou idéales, une mise en scène de la violence sans faux semblant mélangée à du pur mélo qui fait pleurer dans les chaumières, des rebondissements permanents, des surprises qui créent l’événement, un art consommé du suspense et une intrigue compréhensible par tous. Autre clé du succès, la mise en scène d’un Paris des bas-fonds qui fait frissonner le bourgeois. Un Paris d’avant les travaux d’Hausmann, un Paris en pleine expansion et en pleine ébullition où des dizaines de milliers de personnes n’ont que le vol comme moyen de subsistance.
Alors que ce n’était pas forcément son objectif au départ, Sue devient malgré lui l’historien du peuple, le premier à écrire à hauteur d’ouvrier, de bandit, de repris de justice, de prostitué, le premier à dire les douleurs, les misères les crimes, les vices et les vertus des sans-grades. Son roman-feuilleton devient un roman social et engagé. Il est aussi le premier romancier asservi à son public, dépassé par le succès de ses personnages, croulant à la fois sous les louanges et les critiques. Bref, Les Mystères de Paris ont vraiment connu un succès hors-norme dans l’histoire de la littérature française, un succès qui méritait bien une nouvelle publication en poche quelque 180 ans après la première.
La lecture de ce premier tome (il y en a quatre au total) a été pour moi un enchantement. On comprend au fil des pages pourquoi une telle histoire a soulevé autant d’enthousiasme que de défiance. Qualifié de «roman infréquentable », amoral, sulfureux, il a clivé et fasciné, passionné surtout. J’ai le deuxième volume sous le coude, hâte de m’y plonger dès que l’occasion se présentera !
Les Mystères de Paris T1 : L’île de la Cité d’Eugène Sue. 10-18, 2023. 450 pages. 8,90 euros.
Le rendez-vous des Classiques s'invite pour la dernière fois de la saison autour
des thèmes de l'indignation et de la révolte.
Les liens de tous les billets proposés seront à retrouver chez Moka








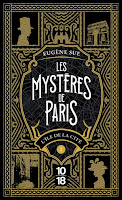

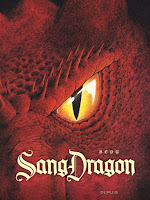

.png)




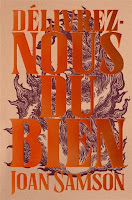


.png)
