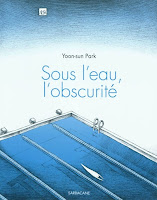A la fin des années 80, Min-Sun, huit ans, est une petite coréenne comme les autres. Dans un pays en plein expansion économique, elle doit, comme sa grande sœur Min-Jin, devenir une battante. Poussées par leur mère, les deux enfants enchaînent les cours du soir et les séances de soutien scolaire pendant les vacances. Au programme, mathématiques, anglais, piano et surtout natation. Min-Sun déteste la piscine, au contraire de Min-Jin qui est la meilleure nageuse du quartier. Étouffée par cette éducation à la dure, la petite fille subit sans broncher l’autorité maternelle, l’agressivité des professeurs et l’étrange amitié de certaines copines. Une jeunesse tout sauf heureuse, loin s’en faut.
Yoon-sun Park sonne une charge implacable contre une société coréenne où la rigidité de l’éducation défendue par certains parents peut être vécue comme un véritable traumatisme. Le personnage de la mère est d’une froideur effrayante. Elle ne dispense à ses enfants aucun signe d’affection. Son seul souci est de préparer ses filles à affronter un monde du travail ultra-concurrentiel où seuls les plus forts survivent. Une intention certes louable mais qui, à l’évidence, trouble grandement sa cadette.
Je ne peux m’empêcher de comparer ce titre avec la série Marzi de Marzena Sowa et Sylvain Savoia. Cette série retrace la jeunesse d’une petite fille dans la Pologne des années 80 qui s’interroge sur l’évolution de son pays et dont la mère est autoritaire et très peu affectueuse. La différence, c’est que Marzi est une enfant curieuse, vive, qui s’extasie, s’indigne ou se révolte. Elle exprime clairement ses sentiments, ce qui la rend touchante. Min-sun ne fait que subir une situation qui l’affecte mais qu’au final elle trouve normale. Son quotidien est, comme celui de Marzi, terriblement difficile. Cependant, on ne ressent aucune empathie à son égard. Sans doute est-ce dû à une certaine pudeur, une volonté de ne pas afficher ses états d’âme. Le problème, c’est que ce manque de sensibilité ne m’a pas permis de rentrer véritablement dans le récit. J’ai parcouru les événements sans jamais me sentir vraiment concerné.
Il faut dire aussi que le dessin ne m’a pas du tout inspiré. Le trait est souple mais sans âme. Les personnages ressemblent à des poupées de chiffon aux membres élastiques. La bichromie de bleu et de gris renforce le coté froid de l’ensemble et les décors manquent de relief et de détails. Bref, voila un ouvrage qui m’a laissé de marbre.
Sous l’eau, l’obscurité de Yoon-Sun Park, Sarbacane, 2011. 160 pages. 19.50 euros.
L’info en plus : Ayant conscience d’être sans doute passé à coté de l’essentiel (j’ai lu plusieurs critiques très positives dans des revues spécialisées), je propose de faire ce titre une BD voyageuse. Je pense en effet qu’elle mérite d’autres avis car j’ai l’impression de ne pas l’avoir appréciée à sa juste valeur. Si vous êtes intéressé(e), contactez-moi : dunebergealautre@gmail.com, je vous la ferais parvenir dans les plus brefs délais.