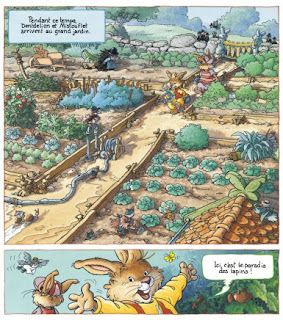|
| Hanokage © Doki Doki 2012 |
Adapté d’une série animée en 12 épisodes ayant connu un énorme succès lors de sa diffusion à la télévision début 2011, ce manga en 3 volumes s’est payé le luxe de devancer des poids lourds tels que Bleatch ou Naruto lors de sa publication au Japon.
Pour moi, un manga estampillé « Magical Girl » est un titre dans lequel des jeunes filles aux costumes improbables se voient dotées de pouvoirs magiques et luttent avec malice contre les forces du mal. Sailor Moon, en gros (en même temps, c’est la seule série de ce type que je connaisse vraiment). Loin de l’univers acidulé et kawaï des classiques du genre, Puella Magi Madoka Magica apparaît au final bien plus sombre et torturé. Les enjeux sont pour les héroïnes plus complexes que le simple fait de devenir une « magical Girl ». Leur nouveau statut met réellement leur vie en danger et surtout le pacte passé avec le gentil Kyubei (qui ne l’est d’ailleurs peut-être pas tant que ça) implique des sacrifices et des contraintes dont elles sont loin d’imaginer la réelle portée. Quelque part, ce type de récit très balisé semble, grâce à cette série, passer à l’âge adulte. Fini les bluettes et la frivolité, place à la noirceur et à une lutte sans merci contre des sorcières qui répandent le désespoir et poussent les gens au suicide. Du lourd, quoi, même si le début de l’intrigue peut laisser croire que l'on reste dans de l’ultra classique.
Le dessin, sans être révolutionnaire, reste fin et précis. Autre point non négligeable, les différents protagonistes se reconnaissent au premier coup d’œil, ce qui est loin d’être toujours le cas avec des mangas de ce type.
Bref, pour moi qui ne suis pas, mais alors pas du tout, le public cible, ce premier volume a constitué une très agréable surprise. Sachant qu’il n’y aura en tout que trois tomes, je pense que je vais avec plaisir suivre les aventures de Madoka et de ses consœurs jusqu’à leur terme.
Puella Magi Madoka Magica T1 de Hanokage. Doki Doki, 2012. 144 pages. 7,50 euros.
 |
| Hanokage © Doki Doki 2012 |